En franchissant les portes de la Grande Mosquée de Paris ce matin, nous ne pouvions nous empêcher de penser aux nombreuses personnes, de toutes confessions, qui ont traversé ce même seuil depuis près d'un siècle. Ce lieu emblématique, bien plus qu'un simple édifice religieux, raconte une histoire fascinante de gratitude, d'ouverture et de dialogue interculturel. La Grande Mosquée de Paris représente avant tout un geste de reconnaissance de la France envers les soldats musulmans tombés pour elle pendant la Première Guerre mondiale. Inaugurée en 1926, elle est devenue la première mosquée métropolitaine de France.

Un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale
L'histoire de la Grande Mosquée de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale est un témoignage bouleversant de courage et de solidarité interreligieuse. Si Kaddour Benghabrit, premier recteur de la mosquée, a orchestré une opération de sauvetage remarquable qui mérite d'être racontée en détail. Benghabrit n'était pas un simple administrateur religieux. Né en Algérie en 1868, il était un diplomate chevronné et un fin stratège. Sa position sociale et ses relations avec les autorités françaises lui ont permis de naviguer habilement dans les eaux troubles de l'Occupation1. Cette double position - respecté par Vichy mais secrètement résistant - lui a donné la marge de manœuvre nécessaire pour organiser des sauvetages.
Le système de sauvetage
Le système mis en place était ingénieux dans sa simplicité. La mosquée délivrait des certificats attestant que des personnes juives étaient de confession musulmane. Cette stratégie exploitait une faille : les nazis et le régime de Vichy avaient du mal à différencier les populations juives et musulmanes d'Afrique du Nord2.
Concrètement, voici comment le système fonctionnait : les caves et sous-sols de la mosquée servaient de cachettes temporaires, des certificats de complaisance étaient établis, attestant une prétendue origine musulmane, un réseau de résistants guidait les fugitifs vers d'autres refuges ou vers la zone libre et le hammam de la mosquée servait également de lieu de passage, les fugitifs se mêlant aux clients habituels3.

Les chiffres et les témoignages
Bien que les estimations varient, les historiens pensent qu'environ 500 à 1600 personnes juives ont été sauvées grâce à l'intervention de la mosquée4. Parmi elles, on compte notamment le chanteur Salim Halali, dont l'histoire est particulièrement bien documentée. Pour le sauver, Benghabrit serait allé jusqu'à faire graver une fausse pierre tombale au nom du père de Halali dans le cimetière musulman de Bobigny5.
Albert Assouline, un survivant, témoigne : "Aucun Juif ayant frappé à la porte de la Mosquée n'a été refusé. Si Kaddour Benghabrit nous a donné l'asile, nous a fourni des certificats musulmans, et grâce à sa complicité, de nombreux Juifs ont pu franchir la ligne de démarcation en zone libre."6
Un héritage de courage
Ce qui rend cette histoire particulièrement remarquable, c'est le risque énorme pris par Benghabrit et son équipe. En cas de découverte, les conséquences auraient été dramatiques, non seulement pour eux mais pour toute la communauté musulmane de Paris. Pourtant, ils ont choisi d'agir, guidés par des principes humanitaires transcendant les appartenances religieuses.
Une reconnaissance tardive
Cette histoire est restée relativement méconnue pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2006 que le film "Les Hommes Libres" d'Ismaël Ferroukhi a contribué à la faire connaître au grand public7. Aujourd'hui, une plaque commémorative dans la mosquée rappelle ces actes de bravoure. Cette histoire résonne particulièrement dans notre époque où les tensions interreligieuses font souvent la une des journaux. Elle nous rappelle que les moments les plus sombres de l'histoire peuvent aussi révéler le meilleur de l'humanité, et que la solidarité peut transcender les différences religieuses et culturelles.

Un carrefour vivant du dialogue interreligieux
La Grande Mosquée de Paris occupe aujourd'hui une place unique dans le paysage interreligieux français. Au-delà de sa fonction première de lieu de culte musulman, elle s'est imposée comme un espace privilégié de rencontres et d'échanges entre les différentes communautés religieuses de la capitale.
Des initiatives concrètes
Lors de ma dernière visite, j'ai pu observer la diversité des activités interreligieuses qui s'y déroulent. Chaque mois, la mosquée accueille des groupes d'étudiants en théologie de différentes confessions. Ces futurs religieux - rabbins, prêtres, pasteurs et imams - se réunissent pour des séminaires communs sur des thèmes qui les concernent tous : la place du religieux dans la société laïque, l'accompagnement spirituel des jeunes, ou encore les défis écologiques vus par les différentes traditions. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la façon dont la mosquée a su créer des espaces de dialogue informels. Le jardin et le café ne sont pas de simples lieux touristiques, mais de véritables zones de rencontre où les barrières tombent naturellement.
Des programmes structurés
La mosquée ne se contente pas d'accueillir des rencontres spontanées. Elle organise régulièrement des événements structurés : colloques sur la coexistence religieuse, cycles de conférences sur les valeurs communes aux monothéismes, et même des actions caritatives interreligieuses. Pendant le Ramadan, par exemple, la mosquée coordonne des distributions de repas où collaborent bénévoles musulmans, chrétiens et juifs.
Formation et éducation
L'aspect éducatif est particulièrement développé. La mosquée propose des formations sur l'islam aux professionnels (enseignants, travailleurs sociaux, personnels hospitaliers) mais aussi des programmes d'éducation interreligieuse pour les jeunes. Ces initiatives visent à déconstruire les préjugés et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle dès le plus jeune âge.

Conclusion
La Grande Mosquée de Paris est bien plus qu'un monument religieux ou touristique. Elle incarne l'histoire vivante du dialogue interreligieux en France et reste un symbole puissant de la façon dont l'architecture peut créer des ponts entre les cultures. Pour nous, elle représente un exemple parfait de la manière dont le patrimoine religieux peut enrichir notre compréhension mutuelle et favoriser le vivre-ensemble. Aujourd'hui, elle joue un rôle central dans le dialogue interreligieux. Elle accueille régulièrement des rencontres entre représentants des différentes confessions et participe activement aux initiatives interreligieuses parisiennes. Nous avons eu la chance d'échanger avec plusieurs fidèles et membres du personnel, tous soulignant l'importance de maintenir cet espace ouvert à tous les visiteurs, quelle que soit leur confession.
Notes
Roberts, Sophie B. (2011). "La Grande Mosquée de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale", Revue d'Histoire de la Shoah, n°198. ↩
Satloff, Robert (2006). "Among the Righteous: Lost Stories from the Holocaust's Long Reach into Arab Lands", PublicAffairs. ↩
Assouline, Albert (1992). "Témoignage sur la Mosquée de Paris", Archives du Mémorial de la Shoah. ↩
Derri, Rachid (2018). "Si Kaddour Benghabrit : Un juste parmi les nations ?", Études coloniales, Vol. 23. ↩
Ferroukhi, Ismaël (2011). Interview dans "Les Cahiers du Cinéma" à propos du film "Les Hommes Libres". ↩
Témoignage d'Albert Assouline, Archives du Mémorial de la Shoah, 1992. ↩
"Les Hommes Libres", film d'Ismaël Ferroukhi, 2011. ↩

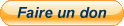
Comentários